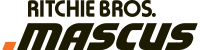Glyphosate prolongé jusqu’en 2033 : quels enjeux autour de son usage ?
En 2023, l’Union européenne a prolongé l’autorisation du glyphosate de dix années supplémentaires, jusqu’en décembre 2033, malgré de vives contestations. Cette décision divise profondément les États membres et soulève des questions sur l’équilibre entre compétitivité agricole et protection environnementale.
Une décision controversée de l’Union européenne
Le 15 décembre 2023 marquait une date charnière pour l’agriculture européenne avec la prolongation de l’autorisation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2033. Cette décision, prise dans un contexte de fortes divisions entre États membres, renforce les tensions déjà présentes entre impératifs économiques, agricoles et préoccupations environnementales au sein de l’Union européenne.
Un processus décisionnel complexe révélateur des divisions européennes
Le 16 novembre 2023, les pays membres de l’Union européenne se sont retrouvés dans l’incapacité de dégager une majorité qualifiée lors du vote sur le renouvellement de l’autorisation du glyphosate. Cette procédure nécessitait l’accord d’au moins 15 pays sur 27, soit un minimum de 65% de la population européenne. Dans cette impasse, la Commission européenne s’est trouvée contrainte de trancher seule, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.vigueur.
| Position des États | Nombre de pays | Exemples |
| Pour la prolongation | 11 | Allemagne, Pologne, Pays-Bas |
| Contre la prolongation | 9 | Autriche, Luxembourg, Croatie |
| Abstention | 7 | France, Belgique, Portugal |
Un rapport de l’EFSA nuancé aux conclusions controversées
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié en septembre 2023 son rapport d’évaluation. Si l’agence n’a pas identifié de « domaine de préoccupation critique » justifiant une interdiction immédiate, elle a néanmoins souligné des préoccupations significatives. Le rapport met en évidence « un risque élevé à long terme pour les mammifères dans 12 des 23 utilisations proposées » du glyphosate, tout en reconnaissant des « lacunes dans les données » et des « questions non résolues ».
Un compromis pour essayer de mettre tout le monde d’accord
En l’absence de majorité qualifiée parmi les pays membres pour ou contre le renouvellement, la Commission Européenne a adopté en novembre 2023 une décision qui tente de limiter les tensions : le glyphosate est réautorisé pour dix ans, mais cette approbation est assortie de nouvelles conditions et restrictions dont le but est de répondre aux préoccupations de chacun, et bien sûr d’éviter une impasse politique.
Les nouvelles conditions d’autorisation de cette prolongation pour encadrer l’usage du glyphosate sont :
- Interdiction formelle de l’utilisation pour déshydrater les cultures avant la récolte
- Mise en place de mesures de protection renforcées pour les organismes non ciblés
- Possibilité de réévaluation anticipée en cas de nouvelles données scientifiques probantes
L’abstention de la France lors du vote est à l’image des dilemmes auxquels font face les gouvernements européens, tiraillés entre la nécessité de maintenir la compétitivité de leur agriculture et les pressions environnementales croissantes de leurs citoyens.
Mobilisation judiciaire et scientifique à l’encontre de la prolongation
La prolongation de l’autorisation du glyphosate jusqu’en 2033 fait l’objet de multiples contestations qui mobilisent tant les instances judiciaires que la communauté scientifique européenne.
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
Le 11 décembre 2024, le collectif Pesticide Action Network Europe a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour contester la décision de prolongation. Cette action juridique fait suite à un premier recours déposé le 1er août 2024 par trois associations françaises : Agir pour l’Environnement, Criigen, et le collectif des maires anti-pesticides, représentées par l’avocate Corinne Lepage.
Les motivations de ces recours reposent principalement sur le rejet de ce que les plaignants qualifient de « preuves scientifiques critiques » non prises en compte par les autorités européennes. Angeliki Lysimachou, représentante de PAN Europe (Pesticide Action Network Europe), estime qu’une audience pourrait avoir lieu fin 2026, la CJUE pouvant examiner simultanément les différents recours engagés.
Nouvelles données scientifiques controversées
L’Institut Ramazzini a publié en 2024 une étude suggérant une hausse du nombre de tumeurs chez des rats exposés à des doses de glyphosate conformes aux normes européennes actuelles. Ces résultats ont conduit la Commission européenne à demander le 24 juin 2025 une réévaluation par l’EFSA et l’ECHA, remettant en question l’évaluation initiale.
Une mobilisation politique et citoyenne
Le 30 juin 2024, une pétition menée par l’eurodéputé Christophe Clergeau, soutenue par 33 parlementaires européens, a demandé une révision formelle de l’autorisation du glyphosate. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’initiative citoyenne européenne de 2017 qui avait recueilli 1 070 865 signatures pour l’interdiction de cet herbicide.
« Les nouvelles recherches remettent fondamentalement en question l’évaluation de l’EFSA », souligne Christophe Clergeau dans sa correspondance à la Commission européenne.
Impact sur l’agriculture française et européenne : entre nécessité économique et transition écologique
La prolongation de l’autorisation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2033 soulève des questions complexes pour les exploitants agricoles français et européens, tiraillés entre impératifs économiques et pressions environnementales. Cette décision de la Commission européenne redéfinit les perspectives du secteur pour la décennie à venir.
Dépendance économique et contraintes opérationnelles
Pour les agriculteurs français, le glyphosate est un produit qui relève presque de la nécessité. Selon les données sectorielles, cet herbicide représente près de 40% du marché français des désherbants, avec environ 8 000 tonnes utilisées annuellement. Les grandes exploitations céréalières, notamment dans le Bassin parisien et les régions de monoculture intensive, ont massivement recours à ce produit pour maintenir leur compétitivité.
La FNSEA souligne que l’interdiction immédiate du glyphosate entraînerait une hausse des coûts de production de 15 à 25% selon les filières. Les alternatives actuelles, comme l’acide pélargonique utilisé par la SNCF depuis 2022, restent deux à trois fois plus onéreuses et nécessitent des applications répétées.
Cadre réglementaire français et restrictions sectorielles
Malgré l’autorisation européenne, la France maintient ses restrictions nationales. Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a confirmé l’interdiction dans les cimetières, espaces publics et zones sensibles, mais l’usage agricole du glyphosate est maintenu. Cette différenciation témoigne de la volonté française de concilier productivité agricole et protection environnementale.
| Secteur | Statut en France | Alternatives disponibles |
| Agriculture | Autorisé avec restrictions | Désherbage mécanique, binage |
| Espaces publics | Interdit | Acide pélargonique, vapeur |
| Cimetières | Interdit | Paillage, désherbage manuel |
| Transport ferroviaire | Substitué | Acide pélargonique |
Enjeux de compétitivité européenne et mondiale
L’abstention française lors du vote de novembre 2023 illustre les tensions entre ambitions environnementales et réalités économiques. Avec 17 pays européens favorables au renouvellement, dont l’Allemagne où Bayer-Monsanto maintient sa production, les agriculteurs français craignent une distorsion de concurrence.
« La compétitivité de notre agriculture passe par l’harmonisation des règles au niveau européen. Nous ne pouvons pas accepter de désavantages concurrentiels face à nos voisins », déclare François Purseigle, sociologue rural.
Un herbicide controversé dont la prolongation ne fait pas l’unanimité en Europe
Malgré lui, le glyphosate dépasse son statut de simple herbicide et se place comme le symbole de choix sociétaires et environnementaux importants.
D’un côté, le maintien de cet herbicide répond à une réalité économique pour de nombreuses exploitations agricoles européennes. Les alternatives restent plus coûteuses et techniquement contraignantes pour les exploitants. La crainte de distorsions de concurrence au sein du marché unique a clairement pesé dans la balance.
De l’autre, cette autorisation intervient dans un contexte de défiance scientifique et citoyenne grandissante. Les recours juridiques engagés, les nouvelles études controversées et la mobilisation persistante de la société civile témoignent d’une fracture durable entre décision politique et préoccupations sociale. Les restrictions ajoutées par la Commission apparaissent comme des compromis insuffisants aux yeux des opposants.
À plus long terme, cette prolongation interroge la capacité de l’Europe à opérer sa transition agroécologique. En maintenant sa dépendance à un produit aussi controversé, l’Union européenne prend le risque de ralentir l’innovation vers des alternatives durables, tout en alimentant la défiance des citoyens envers ses processus d’évaluation des risques.