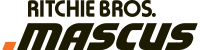Zones de Non-Traitement (ZNT) : tout savoir sur la réglementation et ses conséquences
Les zones de non-traitement (ZNT) font suite à une réglementation agricole entrée en vigueur en 2020 pour protéger les riverains et l’environnement des produits phytosanitaires. Cette mesure impose des distances de sécurité à respecter lors des épandages, auxquelles les professionnels agricoles doivent se conformer en adaptant leurs techniques.
Comprendre la réglementation des zones de non-traitement
Les zones de non-traitement ont été mises en place pour protéger les riverains et l’environnement des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. La réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, redéfinit les pratiques agricoles en imposant des distances de sécurité strictes lors des traitements.
Le cadre réglementaire des ZNT
En France, les zones de non-traitement sont principalement définies par l’arrêté du 4 mai 2017, modifié plusieurs fois, qui régit la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces règles font mention des distances de sécurité à respecter près des points d’eau et des habitations lors du traitement des parties aériennes des plantes, dans le but de protéger l’environnement et la santé publique.
Les distances de sécurité selon les types de produits
La réglementation établit une classification précise des distances à respecter en fonction de la dangerosité des produits utilisés :
| Type de produit / culture | Distance de sécurité de base | Réduction possible via une charte départementale |
| Substances CMR1 / Perturbateurs endocriniens | 20 m (incompressible) | Non |
| Substances CMR2 (pour usages listés) | 10 m (incompressible) | Non |
| Arboriculture, Viticulture, Cultures hautes (>50 cm) | 10 m | Oui (peut être réduite à 5 m avec matériel anti-dérive) |
| Autres cultures (ex : céréales, cultures basses) | 5 m | Oui (peut être réduite à 3 m avec matériel anti-dérive) |
| Produits de biocontrôle, substances de base, produits utilisables en agriculture biologique | 0 m | Non applicable |
Activement tenue à jour, la liste des produits phytosanitaires concernés par une distance de sécurité incompressible de 20 mètres a été actualisée le 16 juillet 2025 par le ministère de l’Agriculture.
Protection des points d’eau et zones non cultivées
Les ZNT s’étendent à la préservation des milieux aquatiques. Une ZNT par défaut de 5 mètres aux abords des points d’eau est appliquée à tous les produits phytosanitaires. Cette distance peut être portée à 20 ou 50 mètres selon l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné.
Il est possible de réduire les ZNT de 20 m ou 50 m à 5 m si deux conditions sont simultanément remplies :
- Présence d’un dispositif végétalisé permanent (comme une haie ou une bande enherbée) d’au moins 5 m de large en bordure du point d’eau.
- Mise en œuvre de moyens anti-dérive homologués (comme des buses spécifiques) permettant de réduire d’au moins les deux tiers le risque de dérive vers les milieux aquatiques.
Les points d’eau concernés sont définis par arrêté préfectoral dans chaque département, et il est conseillé de consulter les cartographies interactives mises à disposition par les services de l’État. Les zones non cultivées adjacentes (bois, taillis, fossés, mares ou bords de routes larges, à l’exclusion des parcelles cultivées et des voies de circulation) bénéficient également d’une protection particulière.
Des accords et des équipements de pulvérisation adaptés pour réduire les distances
Si les zones non traitées contraignent les agriculteurs, les accords régionaux et l’utilisation de certains équipements peuvent aider à réduire la distance de traitement. L’activité agricole s’en trouve préservée, au même titre que la santé des populations locales.
Des chartes départementales d’engagement pour réduire la distance de traitement
Les chartes départementales d’engagement peuvent aider à assouplir les contraintes de distance. Ces documents, négociés localement entre les représentants agricoles et les préfectures, permettent de réduire les distances de sécurité de 20 mètres à 10 mètres, voire à 5 mètres selon les produits utilisés. La signature de ces chartes conditionne l’utilisation d’équipements spécifiques et l’adoption de bonnes pratiques de pulvérisation. Ces accords prévoient notamment des obligations de communication préalable aux traitements et l’utilisation de matériel certifié anti-dérive.
À noter : l’arrêté interministériel du 14 février 2023 limite la distance de sécurité minimale à 10 mètres, sans possibilité de réduction, pour les traitements réalisés à proximité des lieux mentionnés dans le code rural et de la pêche maritime.
Les équipements recommandés pour limiter la dérive
Certains équipements permettent de réduire la distance de traitement dans le cadre des chartes départementales d’engagement. Ces dispositifs doivent démontrer une réduction de la dérive d’au moins 66% pour les cultures basses et de 66% à 75% pour les cultures hautes.
- Buses anti-dérive : buses à injection d’air, buses à fente calibrée réduisant la formation de fines gouttelettes
- Systèmes de confinement : panneaux récupérateurs, tunnels de pulvérisation pour les cultures en rangs
- Matériel de précision : pulvérisateurs assistés par air, systèmes de guidage GPS pour optimiser les passages
- Capteurs météorologiques : anémomètres embarqués pour adapter les conditions de traitement
Ces équipements peuvent être chers, mais permettent de concilier respect de la réglementation et efficacité des traitements phytosanitaires.
La liste des produits concernés par une distance incompressible de 20 mètres, mise à jour le 16 juillet 2025 par le ministère de l’Agriculture, reste consultable en ligne et constitue la référence pour déterminer les distances applicables selon les substances actives utilisées.
Impact sur les pratiques agricoles et adaptations nécessaires
Les Zones de Non-Traitement bouleversent les habitudes séculaires de l’agriculture française. Elles contraignent les exploitants à repenser leurs méthodes de travail sans pour autant abandonner leurs productions traditionnelles et leurs matériels agricoles. Pourtant, cette transformation réglementaire ouvre la voie à des innovations agronomiques durables et à une meilleure coexistence avec les territoires ruraux.
Adaptation des systèmes de production sans changement d’orientation
Planter des couverts favorables à l’environnement tels que le trèfle, la vesce, le pois fourrager ou la féverole peut être une première réponse aux exigences des ZNT. Ces bandes enherbées en bordure de parcelles créent une barrière naturelle entre les zones traitées et les habitations. Les mélanges de légumineuses et de graminées, notamment, fixent l’azote atmosphérique tout en limitant la dérive des produits phytosanitaires.
Les cultures à bas niveau d’intrants (BNI) gagnent du terrain dans les exploitations qui rencontrent des contraintes de ZNT. Il est ici question de pratiquer une rotation diversifiée et l’utilisation raisonnée des intrants, de manière à réduire naturellement la pression phytosanitaire. La création de prairies temporaires et d’espèces pérennes dans l’assolement permet de créer des zones tampons naturelles, particulièrement dans les régions viticoles où la proximité avec l’habitat rural reste fréquente.
Sanctions pénales et respect de la réglementation
Le non-respect des ZNT expose les agriculteurs à des sanctions pénales sévères. Le tribunal judiciaire de Valence a ainsi condamné trois exploitants pour avoir épandu des herbicides à base de glyphosate à moins de cinq mètres de cours d’eau protégés. Cette pratique viole les dispositions de la loi sur l’eau de 1992 et de la loi biodiversité de 2016.
Communication et bon voisinage rural
L’instauration d’un dialogue constructif avec les riverains est parfois indispensable pour prévenir les conflits. Certaines exploitations mettent en place des systèmes d’information préventive, notamment par SMS, pour avertir les habitants des traitements programmés. Cette démarche de transparence, bien que non obligatoire, contribue à apaiser les tensions et à maintenir l’acceptabilité sociale de l’activité agricole en milieu périurbain.